Al Baron, pseudonyme pour Alain Collombet, ancien directeur d’hôpital.
Un commandant de police et un capitaine de gendarmerie, en plein coeur de la Bourgogne, enquêtent sur plusieurs meurtres.
Roman policier mais aussi réflexions sur la nature et la condition humaine dans une société en perte de repères. De nombreuses références oenologiques, musicales et littéraires amènent le lecteur à faire sa propre interprétation des différentes pistes de lecture proposées.
Résumé
Plusieurs femmes sont découvertes mortes, dénudées, en pleine nature.
Depuis le cœur de la Bourgogne, un commandant de police et un capitaine de gendarmerie se lancent à la poursuite du meurtrier.
Les histoires personnelles vont s’entrechoquer.
Les illusions personnelles voleront en éclats.:
Seule la nature humaine persistera, ainsi faite de la vie à la mort.
Premier chapitre
Fin avril 2004 : Meurtre au bord du Canal de Bourgogne
Le sillon de l’eau vert sombre du canal de Bourgogne serpentait entre les deux rives désertes, en dehors des peupliers géants décorés bien contre leur gré de boules de gui. Plus les années passaient plus ce parasite se multipliait. Seuls les enfants l’appréciaient encore pour les décorations de Noël. Le froid s’insinuait dans cette solitude perturbée seulement par quelques cris désespérés d’oiseaux à l’approche de la nuit ; les couples de hérons cendrés qui repeuplaient la vallée depuis quelques années étaient déjà retournés dans leurs nids au-dessus des grands arbres de quelques propriétés ou vergers.
La proximité de la rivière, l’Ouche qui donnait son nom à la vallée depuis Lusigny, assez haute et tourmentée suite aux pluies récentes, en contre bas accentuait l’humidité du soir d’un printemps tardif suivant un hiver particulièrement clément ; certains prés où paissaient des vaches ou des moutons étaient gorgés d’eau. Le ciel, chargé de nuages, obscurcissait encore le paysage provoquant une atmosphère angoissante et mystérieuse ; dans une heure il ferait nuit complètement. Déjà dans la pénombre naissante, le marcheur, activant son pas, trébuchait parfois sur quelques nervosités anguleuses du chemin de halage, torturé par les intempéries et les roues des tracteurs ou autres véhicules tout terrain. Dans sa hâte il n’avait pas le souci de regarder les ombres angoissantes qui se profilaient aux détours des méandres du canal et des trouées de la végétation.
A quelques centaines de mètres, sur la gauche, la route départementale desservant la vallée jusqu’à Pont-de-Pany, déroulait son revêtement sombre interrompu par des véhicules fuyant cette solitude, au milieu de cette vallée entre les deux versants boisés. Les arbres en contre bas du chemin de halage, peu fournis encore, avaient pour certains des branches torturées, recroquevillées comme les doigts d’un vieillard trahi par ses rhumatismes. Aucun signe de présence humaine en dehors du marcheur ne venait perturber le silence.
Le curé de la paroisse revenait d’une bénédiction pour un vieillard d’un hameau voisin : la Serrée, à quelques centaines de mètre de l’Abbaye cistercienne du XIIème siècle de Labussière. Famille attristée dans un moment de détresse où la présence du prêtre relevait plus certainement de la tradition que de la volonté de l’ancien agriculteur, bien connu dans la vallée pour son sens libertaire et son franc parler.
Figé dans ses pensées, sa marche rapide, saccadée et chaotique donnait à penser que le père Clément était obsédé par un but inatteignable. Il ne se préoccupait pas de ce paysage étouffant malgré l’humidité pénétrante. En homme simple, il ne craignait pas les éléments terrestres même hostiles, mais se désolait de n’avoir plus que quelques brebis égarées dans les églises le dimanche matin : la désertification des villages alliée à la pénurie financière du diocèse avaient conduit l’archevêque à nommer un homme de dieu pour plusieurs villages.
Autrefois, même si les hommes ne fréquentaient pas trop les lieux de culte, en dehors de quelques-uns pour lesquels il ne se faisait guère d’illusion quant aux croyances et malheureusement aux actes de la vie courante, les femmes étaient sa joie pour éclairer son sermon. Elles étaient d’ailleurs les garantes de traditions et d’ordre, pensait-il. Aujourd’hui avec les nouvelles conditions de la vie moderne elles n’avaient plus le temps et surtout plus l’envie, la nécessité de parler du religieux, de se confesser, d’animer quelques récréations au profit des bonnes œuvres. On ne parlait plus spontanément avec le curé, comme avec l’instituteur d’ailleurs. Les fêtes étaient devenues plus païennes, plus pragmatiques, comme les vide-greniers. Et quand tout allait de travers dans un couple on n’allait plus voir le curé mais un avocat pour le divorce en espérant faire le plus de mal possible à l’autre, le futur ex. Quant aux enfants dissipés, craintifs encore des remontrances parentales et de croyances mal assimilées, ils avaient laissé la place à d’autres enfants plus préoccupés par les loisirs, l’informatique.
Aussi se posait-il de plus en plus la question de son apostolat, car lucidement il reconnaissait que si tout n’allait pas au mieux dans le meilleur des mondes, tout ne semblait pour autant pas aller très mal, sinon plus mal qu’ailleurs. Avec sa lucidité paysanne il s’estimait privilégié dans un environnement apaisé. Ayant vécu quelques années en Afrique, au Cameroun dans le nord du pays au-dessus de Yaoundé, indépendamment du climat que sa constitution physique ne lui avait pas permis de supporter facilement, il estimait que sa condition actuelle aurait malgré tout pu faire envie à certains religieux recherchant une vie paisible, mal préparés à leur sacerdoce. La misère était réelle mais aussi relative.
D’ailleurs il était respecté, bénéficiait d’invitations à toutes les manifestations du canton. La lecture de la presse sur les événements survenant dans le monde le confortait dans cette idée de satisfaction relative ; sans doute un pêché d’indifférence ou d’orgueil commençait-il à poindre. Son ministère semblait lui échapper. Mais pouvait-il, devait-il se reprocher d’être en cet endroit à cet instant. On ne pouvait culpabiliser un enfant né dans ce monde matérialiste en France, en occident, par rapport à un enfant des townships de Johannesburg, des bidonvilles de Conakry, de Nairobi, aux enfants asiatiques travaillant dès l’âge de 5 ans dans certaines usines, à ceux de Gaza, privés d’espérance. Ce qui choquait c’était la différence, les comparaisons de niveau de vie, de confort, d’accès aux soins et à la culture : c’était l’autonomie intellectuelle et économique dont jouissait l’homme moderne par rapport aux malheureux dans le monde qui souffraient de pauvreté, de soumission, d’absence de liberté, de reconnaissance en tant qu’être humain, pendant que d’autres refaisaient le monde dans des lieux comme Davos, spéculaient à Manhattan ou à la City, se concertaient à travers les G7, G20 ou autres.
Juste après le pont qui enjambait la route sinueuse en montée, reliant la vallée à la commune de Saint-Jean de Bœuf, un peu avant l’écluse, l’avant dernière avant sa destination, la cure de Gissey, son regard fut néanmoins attiré par une forme humaine. En s’avançant il découvrit un corps dénudé de femme. Elle était allongée sur le bas-côté à gauche, juste le long de l’Ouche. S’étant rapproché avec précautions, malgré la pénombre naissante et le choc naturel, il lui sembla reconnaître le visage d’une habitante de Barbirey, la commune la plus proche. Celle-ci avait visiblement été poignardée, du sang étant répandu sur elle et ses habits éparpillés à côté d’elle. Sans bien connaître cette femme, il se rappela l’avoir vue encore la semaine dernière avec une de ses amies, vêtue à ce moment d’une tenue printanière de saison, autant qu’il ait pu en juger ; ses connaissances en matière de tenue vestimentaire féminine n’étaient pas dans son domaine de compétence. Elle l’avait salué très enjouée avant de s’éloigner vers sa voiture. Il ne put s’empêcher de regarder les formes de ce corps dénudé, sans doute encore en pleine vie il y a quelques heures en s’attardant plus que de nécessité. Il pensa qu’il réglerait ce péché de concupiscence ce soir à l’occasion de ses prières dans sa solitude, face à lui-même avec sa foi et ses interrogations métaphysiques.
Ayant repris ses esprits, il se précipita vers la maison en pierre isolée, située juste avant le pont pour téléphoner à la gendarmerie de Sombernon, le chef-lieu de canton. Cette maison avait été rénovée récemment. Autrefois elle était occupée par une famille bien connue dans le village et qui s’occupait de gérer le passage des péniches sur le canal. Par chance le propriétaire était rentré et sa famille présente. Il s’expliqua rapidement avec difficulté, les mots s’entrechoquant, en provoquant un certain émoi, si bien que la mère de famille accompagna les enfants dans leurs chambres.
Dans la demi-heure qui suivit, la nuit étant tombée, le calme de la vallée laissa la place à une effervescence inaccoutumée : voitures bleues de la gendarmerie avec gyrophares, puis fourgon rouge du Service départemental d’incendie et de secours, villageois et curieux de passage. Des éclairages alimentées sur batteries avaient été installés et la scène de crime isolée par un ensemble de rideaux. Pas un centimètre de terrain ne put échapper à cette introspection. Les quelques vaches du pré situé juste de l’autre côté de la rivière regardaient cette distraction quasi nocturne avec intérêt et curiosité tout en ruminant.
Le Lieutenant Berger, chef de la brigade de Sombernon, avait interrompu ses activités en urgence : la découverte d’un corps poignardé allait bouleverser l’activité de prévention, de renseignement et de surveillance à laquelle il était fortement attaché dans ces villages où de nombreuses résidences secondaires étaient visitées régulièrement mais où les crimes présentaient heureusement un caractère exceptionnel.
Berger, en poste depuis un peu plus de cinq années aimait cette vie rurale, dans un paysage qui semblait immuable malgré les attaques du progrès. Il avait été muté à Sombernon, ayant été avant en affectation en zone de gendarmerie dans la campagne lyonnaise péri-urbaine. Ses collègues, malgré sa promotion de grade, très attachés à la métropole rhône-alpine, l’avaient quelque peu chambré avec ce retour à la vie paysanne, l’éloignement de la ville des fêtes de la lumière. En fait cette vie plus calme lui plaisait ainsi qu’à son épouse. Dans quelques temps, il accéderait au grade de capitaine et s’interrogeait beaucoup sur le choix professionnel qui se présenterait à lui, d’autant que sa femme occupée avec leurs trois enfants lui laisserait la responsabilité de la décision pour toute la famille.
Il questionnait présentement le père Clément dans la maison qui avait été en quelque sorte réquisitionnée par la gendarmerie pour plus de tranquillité dans les premières investigations.
Aucun des membres de la famille propriétaire de la maison du pont n’avait pu fournir d’indication précise : ils venaient tous de rentrer avant la nuit lorsque le curé était venu frapper à leur porte tout essoufflé et perturbé.
Après les premières analyses, les éléments pouvaient se résumer rapidement : le cadavre était celui d’Anne Voisin, quarante-quatre ans, résidant à Barbirey, mariée, mère de trois enfants. Son mari prévenu par téléphone ne serait là que vers vingt-deux heures, revenant d’un déplacement professionnel de Besançon. Anne Voisin avait été aperçue sortant de sa maison par une voisine vers seize heures, partant à pied en direction du bas du village. Elle était seule et semblait pressée, ne s’étant pas attardée auprès de sa voisine comme souvent pour échanger quelques mots. Vêtue assez légèrement, sans sac à main, si la voisine se souvenait bien, elle lui avait donné l’impression de sortir pour peu de temps. Le plus jeune des enfants était rentré vers 17 H 30 avec le car de ramassage scolaire ; les deux autres étant en internat à Dijon.
Les vêtements déposés autour du cadavre n’étaient pas abîmés mais seulement tachés de sang, ce qui signifiait qu’Anne avait été poignardée alors qu’elle était déshabillée : s’était-elle déshabillée volontairement, connaissait-elle son assassin, avait-elle eu des rapports sexuels forcés ?
Autant de questions pour lesquelles il faudrait attendre les résultats de l’autopsie ; les réponses permettraient d’orienter la suite de l’enquête.
Après le départ du corps, Berger resta sur la zone de crime pour essayer avec ses hommes de trouver quelques indices. Après une heure de recherche au peigne fin, ils renoncèrent. Le dispositif installé serait démonté le lendemain, de jour, des gendarmes se relayant la nuit pour garder les lieux. Il resta avec un de ses hommes à Barbirey où ils dinèrent frugalement chez le maire, en attendant le retour du mari, Gérard. Le benjamin des enfants était chez une voisine. Le maire ne fut pas d’une grande aide : fortement choqué, le couple était de ses amis ; l’assassinat était un événement exceptionnel dans une commune plutôt habituée à constater le temps qui passe en toute sérénité, à part quelques brouilles épisodiques sur le bruit d’une soirée, l’élagage non réalisé de certains arbres, les coupes de bois ou les bagarres de chien. Il ne comprenait pas qu’une telle chose ait pu se produire. Pour lui le couple était sans histoire, très uni. Il n’imaginait pas qu’Anne, une enfant du village ait pu avoir une double vie. Sa femme lui fit cependant remarquer qu’il n’était pas très psychologue, qu’il avait l’habitude de ne voir que le bon côté des gens et que l’on n’en pouvait jurer de rien, ce qui eut le don de lancer immédiatement une suite de répliques réciproques, comme dans tous les vieux couples. Avant que les échanges ne deviennent plus acerbes, les deux gendarmes prirent congé, Gérard Voisin étant rentré.
La maison située dans les dessus du village était une construction relativement récente. Lorsqu’ils arrivèrent, Voisin était entouré de deux de ses amis.
Effondré, ne réalisant pas la situation encore complètement, il semblait incapable de comprendre les informations qui lui étaient données.
Après trois verres de mirabelle, il avait un peu repris de lucidité et mais pas d’assurance. Etant parti hier en fin d’après-midi à Besançon, à la demande de son patron pour vérifier un équipement agricole qui devait être livré les prochains jours dans la vallée, il avait prévu de ne rentrer que le lendemain dans la matinée. Sa femme et lui ne connaissaient pas de problème dans leur couple, bien au contraire, sa femme lui témoignait un regain de vitalité sexuelle depuis quelques mois. Avec son emploi du temps, travail au Crédit Agricole de Sombernon, une vie familiale prenante, la course à pied une à deux fois par semaine, elle n’avait que peu de temps pour des rencontres en dehors du couple, si tant est qu’elle en ait éprouvé l’envie. Ses amis, très émus, ne savaient pas quelle attitude adopter, et opinaient à chaque phrase de Gérard, comme pour l’encourager sans rien dire.
Laissant le mari à son malheur, ils lui indiquèrent qu’il serait nécessaire qu’il passe à la gendarmerie pour signer une déposition comme dans toute procédure. Il n’eut même pas de réaction de protestation ou de questionnement, comme certains en pareille occasion et se contenta de bougonner un oui faiblement se prenant la tête pour la énième fois entre ses mains rougies d’avoir serré les poings.
Après les avoir salués tous les trois avec des mots de circonstances ils rentrèrent à Sombernon. A leur arrivée, la soirée serait achevée.
Gérard Voisin alla, accompagné d’un de ses amis, rechercher son plus jeune fils : il avait besoin de resserrer le lien familial, de le serrer dans ses bras, même si en pareille circonstance il aurait pu rester dormir chez les voisins. Le village s’endormit, mais dans les maisons la tension n’était pas retombée, avec les questions, l’incompréhension et une certaine psychose naissante. Si le château de Marigny, en surplomb de la vallée, n’exerçait plus qu’une vigilance pacifique, un couvercle sinistre recouvrait le village :
Les nuages couraient sur la lune enflammée
Comme sur l’incendie on voit fuir la fumée,
Et les bois étaient noirs jusques à l’horizon.
Le lendemain, Berger et deux de ses hommes retournèrent à Barbirey pour interroger les habitants, maison par maison pour une enquête de voisinage. Ils s’attardèrent un peu dans deux endroits particulièrement : le château et juste en face dans une résidence qui venait d’ouvrir des chambres d’hôtes. Le passage de nombreuses personnes recherchant le calme, une certaine tradition et un accueil toujours convivial, aurait pu attirer un inconnu avec de mauvaises intentions. Les personnes présentes en cette matinée avaient bien d’autres préoccupations et se montraient un peu inquiètes des événements. Quant aux propriétaires, affairés comme toujours, ils n’avaient rien remarqué en dehors des mouvements dans le village depuis la veille au soir. Ils relatèrent les discussions avec leurs hôtes tous étrangers : belges, anglais et même un couple de japonais, ce qui ne manqua pas de laisser Berger interrogatif sur l’attractivité de la vallée à travers tous ces échanges internationaux.
L’enquête ne donna donc pas d’éléments nouveaux. Le couple était uni avec ses enfants, participant normalement aux activités communales. Anne, une enfant du village avait indiqué récemment au maire qu’elle envisageait de se présenter sur sa liste lors des prochaines élections municipales.
L’amie qui courait parfois avec elle, travaillant à la mairie de Gissey au syndicat intercommunal de la vallée de l’Ouche, il s’y rendit et en profita pour revoir en passant le père Clément également.
Il le trouva en pleine prière pour le repos d’Anne et le soutien à sa famille. Le père Clément semblait désabusé, ne sachant pas trop quoi dire tant le choc rétrospectif semblait le troubler. Berger pensa furtivement que c’était peut-être plus le corps dénudé que le crime lui-même ; il s’en voulut aussitôt tant le brave homme paraissait peiné. Il ne savait pas que le curé, homme de bonne volonté, mais heurté par l’existence du mal avait été repris pendant la nuit par ses doutes sur sa foi. Il avait envié Saul, devenu Paul sur le chemin de Damas, tout en sachant que le doute était lié à la foi : il existait d’ailleurs dans les écrits une religion du doute. Mais pour un croyant qui plus est serviteur de son dieu, le doute était comme un cancer qui ronge de l’intérieur. Et toutes ces contradictions à assumer au quotidien, comme celle de Jérusalem, la ville sainte, placée au milieu du désert sur un rocher, exposée à la lumière céleste et à l’obscurité humaine. Cet affrontement permanent du mal et du bien, de l’espoir et de la désespérance finissait par l’user intérieurement.
L’histoire de la civilisation chrétienne, de la doctrine, donc de la foi révélée, le dépassait de plus en plus. La vie d’un honnête et simple serviteur de Dieu, homme de bonne volonté cherchant à faire le bien, à donner de l’espoir, tel qu’il s’identifiait, n’était réellement pas simple.
De plus en plus, il estimait que nul ne se tient hors de la noirceur comme Michel Maffesoli, référence surprenante pour un curé de campagne. Au moins à la différence de Christophe Colomb qui ne savait pas où il était, lui se positionnait parfaitement malgré le doute dans son univers spirituel, car il lui restait des principes et des valeurs.
Berger le laissa à ses préoccupations et le remercia du temps qu’il lui avait consacré.
Quant à la collègue et amie d’Anne, effondrée, au bord des larmes, elle ne put apporter aucune précision d’intérêt ; elle avait dû téléphoner à quelques-unes de leurs relations communes pour les prévenir. En réalité, elle avait occupé sa matinée à répéter les mêmes phrases éplorées, saccadées avec des sanglots quasi permanents.
Avant de retourner à la gendarmerie, il s’arrêta au Crédit Agricole situé au milieu de la rue principale de Sombernon ; la discussion avec le directeur de l’agence ne lui apporta pas d’élément supplémentaire. Anne était une bonne professionnelle, sérieuse, rigoureuse dans son métier et très appréciée non seulement des clients mais aussi de ses collègues de travail. Elle n’avait pas eu de conflit tant avec les uns qu’avec les autres. Le directeur attira son attention néanmoins sur le fait qu’Anne semblait depuis quelques temps moins enjouée et peut être préoccupée, sans que cela porte sur son travail cependant.
De retour, par téléphone, il apprit les premières indications de l’autopsie en fin d’après-midi : Anne n’avait pas été violée, n’avait pas eu de rapport sexuel avant son assassinat, ni post-mortem. Par contre elle avait dû être assommée avant d’être poignardée. Excepté des coups de couteau, des marques étaient situées au niveau des bras et poignets et bien entendu sur le crâne : elle avait dû sans doute tenter de se protéger, mais sans que des indices le laissent réellement supposer.
Ces informations plongèrent Berger dans une grande perplexité : pourquoi une femme heureuse en ménage, sans histoire, se déshabille en pleine nature devant un homme qui l’étrangle puis la poignarde sans la violer ?
Il procéda ensuite à quelques vérifications sur l’emploi du temps du mari notamment ; celui-ci se présenta à la gendarmerie de Sombernon le surlendemain. Toujours très éprouvé, il avait passé la veille à entourer ses enfants du mieux possible avec la présence des deux grands-mères, très proches et à prévenir les connaissances de la famille. Il n’avait pas d’autres éléments à ajouter sur sa femme et en parlait à l’imparfait avec difficulté ; juste concéda-t-il qu’elle était sujette à quelques sautes d’humeur ces derniers temps, mais sans doute liées à des questions féminines. Il voulait aussi savoir quand les funérailles pourraient avoir lieu, quand lui rendrait-on le corps d’Anne, autant pour les procédures, que pour s’occuper l’esprit avec l’organisation mais aussi pour faire son propre deuil.
Un juge expérimenté aux affaires criminelles, dijonnais, désigné dès le lendemain de la découverte du corps ne s’était pas empressé auprès du Lieutenant Berger dans les premières heures : il était sans doute moins dirigiste avec les gendarmes qu’avec la PJ. Philippe Delcour avait cependant convoqué Berger pour dresser un état d’avancement de l’enquête après les résultats de l’autopsie : une grande perplexité animait les deux responsables au regard des faits troublants, inhabituels dans ce genre de meurtre. Berger devait le tenir informé de la moindre avancée.
Le seul élément susceptible de constituer une ébauche de quelque piste était un appel téléphonique reçu sur le téléphone fixe familial d’une cabine publique située à Dijon en centre- ville le matin même du meurtre.
Les jours et les semaines passèrent sans que l’enquête avança, laissant une famille dans le deuil et sans réponse. Gérard, le mari, avait rapidement été mis hors de cause.
Barbirey retrouvait son calme habituel de village traditionnel. Connu aujourd’hui par les jardins du château, celui-ci avait autrefois hébergé Charles de Foucault, ancien lieutenant de cavalerie à la vie débridée, devenu moine dans le désert algérien et assassiné à Tamanrasset, dans des conditions incertaines du moins quant au commanditaire qui pour certains ne pouvait être que le rival de toujours, l’Angleterre. Sa sœur était mariée avec le propriétaire du château M De Blic. Dans le parc du château, le ru appelé la Gironde descendant du plateau depuis Grenand, continuait à prendre le temps de traverser la mare avant d’aller se jeter dans l’Ouche.
Le Bien public, journal local, dans son édition beaunoise signalait dans un encart l’horrible meurtre survenu à Barbirey. Jeune journaliste Elodie Marchand, peu habituée à traiter de tels sujets s’était contentée de quelques lignes dans la liste des villages pour lesquels ce jour-là des informations étaient données.
Son encart fut repris dans l’édition de Dijon. Dans les jours suivants, quelques informations supplémentaires étaient données relatives à l’identité de la victime, son lieu de travail. On indiquait que l’enquête, confiée à la gendarmerie de Sombernon allait sans doute être difficile en l’absence de témoin ; toutes les hypothèses étaient à ce stade possibles. Comme en pareil cas, le peu de fonds de l’article laissait la place à toutes les suppositions, pour attirer le lecteur et créer un peu d’inquiétude.
Après une dizaine de jours plus personne n’évoquait ce meurtre horrible mais le village restait choqué et inquiet : un assassin circulait librement après s’en être pris à une enfant du pays. Les forêts de Véluze, du Bois de la Ruère, et du Bois de la Montagne étaient moins fréquentées. Depuis sa colline, le vieux Château de Marigny, du moins ce qu’il en restait avec le passage des siècles, ne faisait plus qu’observer l’agitation. L’Ouche continuait à parcourir la vallée avec ses eaux claires et vives à côté du canal aux eaux plus tranquilles.
Barbirey et son hameau de Jaugey, situé en hauteur sur la route en direction de Sombernon, attendaient avec impatience et inquiétude la suite des événements.
Gérard Voisin avait repris son travail, les enfants le chemin des écoles.
Comment se procurer le livre
Vous pourrez commander ce livre en passant par les liens suivants :
Mais aussi sur les sites de Chapitre et de Decitre ou dans toute librairie.

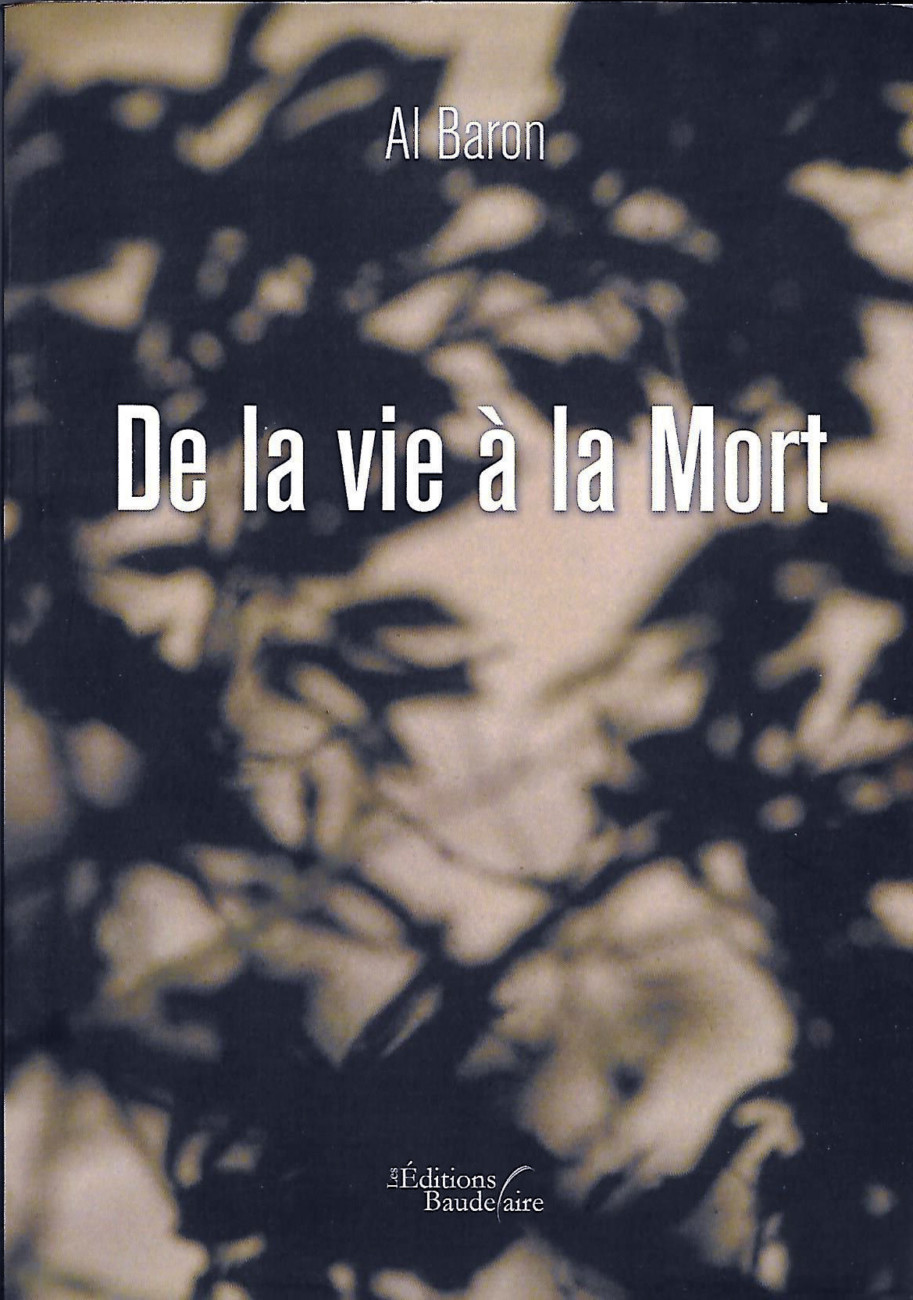
Merci pour ce commentaire